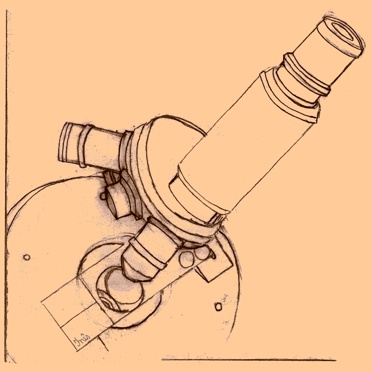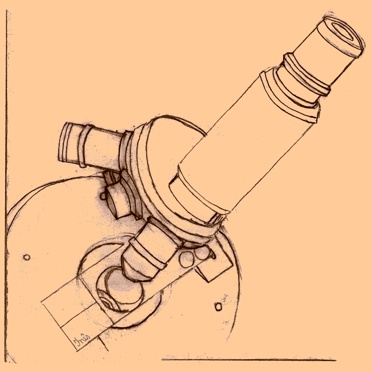|
Simplement à la main, au XIXe siècle, puis éventuellement à l'aide d'un
micromanipulateur, toujours au prix d'une patience sans limite, des
passionnés arrangent des objets microscopiques
– diatomées, écailles d'aile de papillon – pour réaliser d'incroyables compositions artistiques.
Pour illustrer cela, une vingtaine de minutes à n'en pas croire ses yeux :
L'imposant microscope moderne que l'on voit utilisé à quelques reprises est un Nachet "universel" ns400, fier représentant de l'optique française dans les années 1980.
La
société Nachet s'inscrivit dans une lignée prestigieuse en englobant,
en 1896, Bézu, Hausser et Cie qui une dizaine d'années plus tôt
avait racheté l'affaire de Hartnack [ et Prazmowski ], laquelle avait
précédemment repris l'entreprise de Georg Oberhäuser... Rien que des
grands noms.
Le 26/09/2008, dans latribune.fr, on lisait, sous l'intitulé Nachet se bat à coups d'innovation :
c'est sur l'un de ses microscopes que Pasteur a isolé le vaccin de la rage*.
Une photo de l'illustre homme, en compagnie de ce précieux outil,
trône d'ailleurs dans les bureaux de l'entreprise. Nachet, entreprise
fondée à Dijon en 1839, reste le dernier fabricant français de
microscopes.
Un Petit Poucet au regard des concurrents qui ont pour nom – sur le
marché haut de gamme – Zeiss, Leica, Nikon et Olympus.
Mais un Petit Poucet qui tient bon avec le savoir-faire de ses 14
salariés qui ont une ancienneté moyenne de vingt-cinq ans dans
l'entreprise.
|
Pourtant, Nachet a dû cesser ses activités en 2010.
* Oh... Quelle erreur ! Déjà, l'expression « isoler un vaccin au microscope » est pour le moins maladroite, mais surtout...
Que Pasteur  a bien utilisé
un microscope Nachet [ et d'autres marques ] ne fait pas de doute ; par contre, il n'a jamais vu
l'agent de la rage. Il n'aurait pas pu le voir car c'est un virus, trop petit pour être révélé
par la microscopie optique, a fortiori par les instruments encore peu performants dont on disposait en son temps. Le microscope
électronique, développé à partir des années 1930, n'en donna une image qu'en 1963 ! Or
le petit Joseph Meister est entré malgré lui dans la légende en 1885... a bien utilisé
un microscope Nachet [ et d'autres marques ] ne fait pas de doute ; par contre, il n'a jamais vu
l'agent de la rage. Il n'aurait pas pu le voir car c'est un virus, trop petit pour être révélé
par la microscopie optique, a fortiori par les instruments encore peu performants dont on disposait en son temps. Le microscope
électronique, développé à partir des années 1930, n'en donna une image qu'en 1963 ! Or
le petit Joseph Meister est entré malgré lui dans la légende en 1885...
Dans le laboratoire de Pasteur et son équipe, c'est depuis cinq ans que
des recherches acharnées se poursuivaient pour traquer l'ennemi
invisible. Ailleurs,
aussi, bien sûr. En France, en 1852, une récompense avait été promise
par les autorités pour qui trouverait un remède à l'inquiétante maladie.
Méthodiquement diversifiés, prélèvements, traitement des échantillons, filtrations**,
inoculations, patientes attentes ( vu le temps d'incubation variable ),
observations et déductions ont permis de comprendre les mécanismes et
de finalement vaincre le mal par la mise au point d'un vaccin,
sans que le virus soit jamais observé en ces temps-là.
** De la famille des Rhabdiviridae, genre Lyssavirus,
les agents de la rage ont une forme caractéristique "en balle de
revolver". Leur taille a pu être déterminée dès 1936, par
ultrafiltration : généralement, leur longueur varie de 120 à 180 nm, ce
qui est inférieur à la limite de résolution des microscopes optiques.
© P. Atanasiu, 1974
|
| 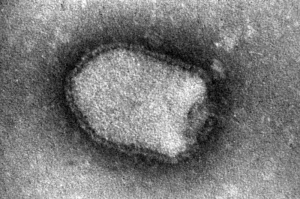
|
[ Il existe bien des
corpuscules intracellulaires, conséquences fréquentes d'une infection
rabique, qui sont décelables en microscopie optique, mais cela n'a été
découvert qu'en 1903 par l'Italien Adelchi Negri, lequel leur a donné son
nom. Il pensait alors que c'étaient des stades évolutifs d'un
protozoaire... ]
|
Dans la vitrine 2.3.,
où sont rassemblés différents modèles de microscopes portables et de terrain [ au Solbosch ], est exposé un Nachet démontable qui peut être configuré en microscope composé ou microscope simple selon les besoins.
Dans l'exposition qui s'est
tenue au CCS de Parentville, au cours de l'été 2017, le n°6 qui se
trouvait dans la vitrine 1 est aussi un Nachet. Son coffret porte une indication qui mérite commentaire...
La couverture du deuxième tome de Le Microscope, Emploi et Applications d'Eugène Séguy [ = le volume XXXIV de l'Encyclopédie Pratique du Naturaliste, aux éditions P. Lechevalier, Paris ] est illustrée par un dessin s'inspirant sans doute d'une rosace faite de diatomées...
Note : il est question de cet ouvrage de référence ailleurs dans les présentes pages, à propos de la recherche de trichines au moyen d'un trichinoscope.
|
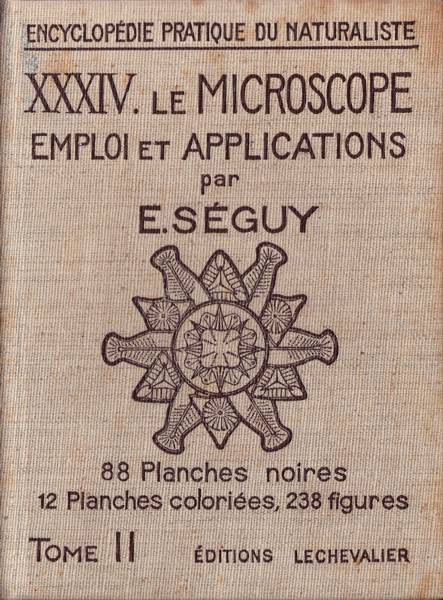 |
|